
Platée, 1745
Jean-Philippe Rameau
Enregistré à Garnier en 2002 / DVD 2004
Quel est le meilleur anxiolytique à la taciturnité ambiante ? Faites fi du marasme obstiné, des nouvelles fâcheuses, des horizons blafards et plongez tête la première dans un marais tourneboulant, pour déguster un festin de quelques grenouilles, pas piquées des vers. Repris moult fois à Garnier durant la dernière décennie, ce spectacle réconcilierait avec l’opéra les plus opiniâtres récalcitrants.
Nous sommes en 1745, à Versailles, le Dauphin, fils de Louis XV, vient d’épouser un laideron, sa cousine l’Infante d’Espagne. Rameau compose pour cette occasion une comédie lyrique, un ballet bouffon, totalement saugrenu. Le compositeur dynamite la norme et détourne les règles de composition pour un tohu-bohu de la fatuité, qui fit grand bruit. Tous en prennent pour leur grade : la nymphe batracienne Platée est jouée par un ténor (l’usage dans l’opéra français était de confier les rôles des nourrices vieillissantes et comiques à des hommes), ce qui la décale du rang des héroïnes formatées et souligne son côté grotesque (tout comme son texte, paré de nombreuses rimes en «oi», ses «Coâ ? Coâ ?» tordants et innombrables). Persuadée que ses charmes glauques et vaseux ont su attirer Jupiter, elle s’imagine en toute bonne foi succéder à Junon dans le Panthéon divin. Rameau la fait redescendre vertement dans son cloaque, rappelant au passage qu’on ne s’extirpe pas aussi facilement de sa condition première et qu’il ne faut jamais prendre au sérieux le baratin des hommes. Le sujet de l’œuvre, l’amour et les noces du plus grand des dieux et d’une naïade ridicule, n’est plus traité à grand renfort de bons sentiments, de morale et de vertu mais piétiné, détourné, bafoué. L’hymen des puissants (mais aussi des Dauphins) devient une tromperie, un mensonge, au détriment des plus humbles. La majesté des dieux (mais aussi des Rois), leur autorité, leurs principes de noblesse et de dignité sont relégués aux oubliettes : le canular, la rosserie, la cruauté, voilà leur quotidien.
Ce pastiche des opéras respectables et un peu poudrés, a le goût d’une sucrerie acidulée, qui oscille entre la franche pantalonnade et l’ironie caustique. La mise en scène maligne de Laurent Pelly (dont on avait savouré au Châtelet La Belle Hélène et La Grande-duchesse de Gerolstein) se permet toutes les folies, tous les délires. Le prologue, où la muse Thalie, le dieu Momus, l’Amour et le poète Thespis, accordent leur voix pour proposer un « spectacle nouveau »,
« Cherchons à railler en tous lieux,
Soumettons à nos ris et le ciel et la terre :
Livrons au ridicule une éternelle guerre,
N’épargnons ni mortels ni dieux. »
se déroule dans une salle d’opéra qui fait face au public de Garnier : les chanteurs nous tendent un miroir et ce sont nos travers qu’ils vont railler : nous sommes sujets, non témoins. Ce décor va se métamorphoser sous nos yeux durant trois actes, se décomposant, pourrissant, couvert de mousse, de sphaigne verdâtre, comme les espérances matrimoniales de Platée qui partent à vau-l’eau. Le marigot est habité de créatures improbables, qui coassent, stridulent, criaillent : les amphibiens déplient leur longues pattes, jouent à saute-grenouille, sous les vents furieux d’une Junon atrabilaire. Les costumes, extrêmement soignés, suffisent à camper les personnages. Platée, toute de vert couverte, à l’exception du nénuphar rose qui lui sert de jupe, traîne un petit sac carré et un collier de perles qui lui donne des allures de douairière anglaise sur le retour, absolument irrésistible. On comprend tout du personnage : son goût des apparences, de la bienséance, des nobles élans, sa candeur, sa naïveté, mais aussi sa vanité, sa crucherie. Le trio divin (Jupiter, Junon et Mercure) semble arriver tout droit du Tennessee, pantalons lamés, robe couverte de strass, cheveux gominés pour dynamiter les bonnes manières désuètes de celle qui a le cœur « tout agité, tout impatienté ».

L’opéra comporte un grand nombre de ballets, surtout dans le dernier acte. La chorégraphe joue aussi du ridicule, du truculent, du décalé, des oppositions, pour tenir cette tension d’une histoire qui ne mollit pas, enrichie de mille détails que l’on découvre au fil des représentations : il y a un monde fou sur scène, ça cavale, ça bondit sans répit, l’énergie féroce passe la rampe et se diffuse dans le public.
Côté voix, volent très au dessus des autres, Yann Beuron, toujours irréprochable et Paul Agnew, qui se glisse dans la robe de Platée avec un bonheur évident. Sa diction est parfaite (impossible de déceler une once d’accent anglais), sa voix convaincante, ses ornements très beaux. Sa gestuelle, son sourire godiche, ses mimiques dérideraient un dépressif chronique. Il réussit à exprimer une réelle féminité, une fragilité émouvante avec une drôlerie, une bêtise qui rend cette naïade très humaine. Bien sûr il y a la Folie, chantée mais surtout interprétée par Mireille Delunsch, dont le grand air du II soulève à chaque fois le public. Choucroutée de boucles blondes comme une Pompadour, la robe couverte de partitions, elle s’avance crânement, la mine bravache, pour brocarder l’union de la dryade et de Jupiter. La Folie s’empare alors de l’orchestre et se lance dans un solo endiablé, une suite de vocalises absolument dominées, qui illustrent ses sarcasmes caustiques. Imaginez une « Reine de la Nuit » sous amphétamines, croisée avec le « Joker » grimaçant.
Il faut bien reconnaître que Minkowski est aussi largement responsable de cette atmosphère de démence partagée. Depuis le temps qu’il fréquente la partition, il en connaît les ressorts comme personne. Je ne désespère pas de le voir un jour vraiment s’envoler au dessus de son pupitre, tant il met de punch à diriger ses troupes. Il insuffle de la vitalité à cette musique, qui déborde et jaillit de la fosse. Ecoutez la vigueur des cordes, la pétulance des bois, les contrastes rythmiques, le mordant des attaques et puis soudain cette douceur qui n’est jamais sucrée mais suave.
Si vous ne reprenez pas une plâtrée de grenouilles, c’est à désespérer !

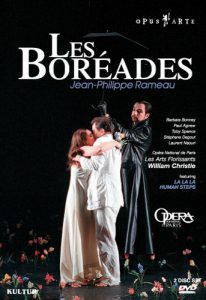
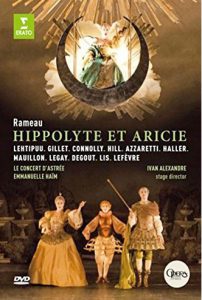
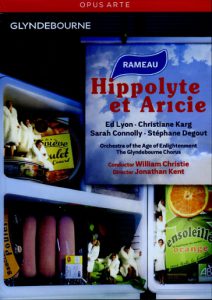
Je suis à 100% d’accord ! En ce moment j’écoute presque en boucle le disque « Ste-cécile » (Purcell/Handel/Haydn) du même Minkowski : que du bonheur !!!
Et dire qu’il y a des exégètes racornis pour lui reprocher ses relectures perso des partitions, ses tempi de folie, ses lamenti délicats… je suis comme toi, une inconditionnelle