
Jean-Christophe Spinosi et son Ensemble Matheus livrent sur scène, pour la première fois depuis 1727, la version originale de la partition, sans coupe, ni arrangement singulier. Suite à de longues recherches sur le livret d’époque et la partition autographe, ils proposent au public la restitution la plus authentique possible, dans la musique et dans l’esprit.
Beaucoup de musicologues, et autres exégètes patentés, (tout comme ma moitié !) délirent sur la partition d’Orlando Furioso, considérée comme la plus aboutie de Vivaldi. Tous de souligner la « maturité lyrique », sa « séduction mélodique », une « couleur instrumentale lumineuse » et une « vitalité rythmique électrisante », des « accompagnements nourris, complexes et variés », « une écriture magistrale ». Alors, pourquoi cette musique me laisse-t-elle de glace ? Sans doute parce qu’elle n’est qu’une quasi succession d’airs de bravoure, que la rythmique est infernale, que la virtuosité supplante la ligne mélodique, que les récitatifs s’enchaînent au détriment des arias : il y a en effet quatre/cinq airs d’une grande beauté (dont le sublime « Sol da te mio dolce amor » de Ruggiero à l’acte I ou la complainte d’Angelica « Poveri affetti miei, siete innocenti » au III), mais c’est bien peu sur plus de trois heures. La musique demande un réel effort pour accepter sans relâche cette exaltation continue, la folie du personnage principal, les scènes de jalousie sans fin, à grand renfort de frénésie, de fièvre, de tumulte qui finissent par me lasser.
L’orchestre est-il à la hauteur du bouillonnement de la partition ? Il est tout simplement remarquable, au service de la musique qui fulgure sans relâche. Je plains les pauvres archets qui doivent sortir lessivés de la représentation, tant leur énergie est soutenue. La fosse tient le tempo insensé et rutile, époustouflant d’agilité et de relief. Les très chiches lamenti qui leur sont offerts sont de pures merveilles, inspirés et aériens, qui contrastent d’une façon bien tranchée avec la tempête déchaînée des cordes démoniaques, des bois et des cuivres qui flamboient. Mais tout sensationnel que soit l’orchestre, la partition reste ce qu’elle est : un magma étouffant, dont je sature très vite.
La distribution des voix est un défi : toutes se doivent d’être au-delà du remarquable, tant le niveau d’exigence atteint des altitudes himalayennes. Pas de rôle secondaire, pas de scène légère où reposer sa voix, aucun temps mort. Trois mezzo(s) et une contralto s’affrontent dans une lutte impitoyable, où celle qui faiblirait se ferait aussitôt engloutir par les autres. Ce n’est plus une scène mais un ring. Á ce jeu des rivalités, Jennifer Larmore (Alcina) sort victorieuse, tant son engagement scénique est sidérant. Elle écope aussi du rôle le plus complexe, tour à tour magicienne enjôleuse, mante religieuse dévorant le jeune Ruggiero, monstre manipulateur, harpie délirante, puis simple créature sans pouvoir, accablée et touchante. Ses da capo sont éblouissants de maestria, ses vocalises intrépides jaillissent comme des feux d’artifice, son énergie débridée déborde, alors tant pis si le timbre est un rien mat. Veronica Cangemini (Angelica) a passé l’âge du rôle – la mezzo, Romina Basso, qui interprète son amoureux Medoro, a l’air d’être sa fille – et fait pâle figure à côté de Larmore. Voix râpeuse, manque de souplesse, couleurs ternes, aigus aigres, elle est la grande déception de cette distribution. L’Orlando de Marie-Nicole Lemieux est aussi frustrant : je n’ai pas été saisie par sa version du paladin, héros légendaire qui devient sous nos yeux un homme très vulnérable. J’ai trouvé son interprétation étonnement fragile, sans fougue ni ardeur et la grande scène de folie du III, totalement surjouée. Les vocalises ne sont pas assurées, la voix s’essouffle, son manque d’aisance pour ce rôle colossal est patent.
Heureusement, il y a notre contre-tenor Philippe Jaroussky, qui irradie comme un soleil. Il ouvre ses jolies lèvres et c’est l’extase. Tout est magnifique : timbre, respiration, nuance, légèreté et agilité, sensibilité du chant et maîtrise des ornements. L’avantage du DVD, c’est que l’on peut se repasser dix fois de suite son « Sol da te », la magie opère sans relâche.
Le baryton Christian Senn (Astolfo) est impeccable – pas désagréable d’entendre une voix grave, ferme, ample et mature dans une partition dédiée à d’autres tessitures et les deux mezzo(s), Kristina Hammarström (Bradamante) et Romina Basso, parfaitement en place, agiles, déterminées et en phase avec leur personnage.
Bilan ? Très mitigé. Á vous de voir, selon votre sensibilité, vos goûts, votre intérêt pour la seule technique stérile et la virtuosité vaine.

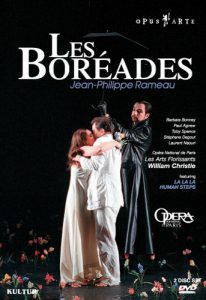
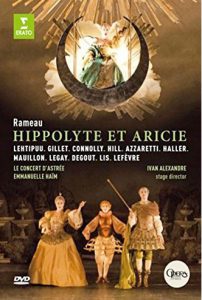
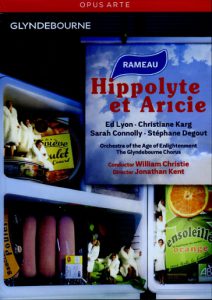
Ô belle baroqueuse, la furia / la follia ne l’avez-vous voulu goûter ? Le régime du baroque n’est-il point pourtant l’excès ?
On nous a seriné du Vivaldi conforme, des 4 saisons à toutes les sauces, et voilà un Vivaldi hors-normes que vous boudez.
Le metteur en scène (de cette représentation) ne connaît manifestement pas la « folle du logis », et pour un ratage, c’est complet, un summum. À inscrire aux Nuls de l’année.
Mais la musique ? que des prouesses techniques ?
Je veux bien reconnaître avec vous qu’on se perd un peu à identifier les personnages dans l’imbroglio des situations, qu’on nous assied le cul entre deux chaises, si j’ose dire en l’occurrence, entre du simple théâtre (tel que va le pratiquer Goldoni) et des morceaux de bravoure, qui font tout de même la gloire de l’opéra.
Des récitatifs chantés, et pas seulement platement récités, ça vous gêne ? Des arias, qui sont effectivement des exercices de prouesses vocales, mais où chacun, ou plutôt chacune, doit, comme vous le soulignez à juste titre, « défendre son morceau », vous trouvez ça de l’estouffade ? On perd sans doute un peu du mélo du melodramma, mais qu’importe le texte pourvu qu’on ait l’ivresse…
Et puis vous connaissez tant d’opéras où l’on a envie à chaque air de demander un bis ?
Vivaldi a là, à notre sens, fait très fort.
J’ajouterais une remarque à votre critique pour ce DVD : l’enregistrement sonore est parfois, incompréhensiblement, défectueux (quand les personnages sont à droite de la scène), et les instruments à cordes sonnent souvent comme des tambours (défaut de l’orchestration à l’origine ?).
Continuez néanmoins à nous régaler de vos auditions-spectacles.
Ah, je me doutais bien qu’un amoureux de la partition allait me tomber rapidement sur le râble !
Bon, en fait nous sommes d’accord sur plein de choses, sauf sur l’excès de virtuosité qui vire pour moi au trop plein alors qu’il vous ravit. Votre oreille est plus accueillante que la mienne, qui est peut être trop formatée. Merci en tout cas pour votre retour (toujours un plaisir de lire des avis un peu différents, qui font réfléchir). Et welcome aboard !