
L’Orfeo, 1607
Claudio Monteverdi
Enregistré à Barcelone en 2002 / DVD 2002
L’ouverture de ce « premier opéra baroque » est un coup de semonce. Sept instruments à vent (trompettes et sacqueboutes) soutenus par la rythmique d’une timbale, font raisonner une ouverture toute martiale, devant très certainement souligner l’entrée du Prince de Gonzague, Duc de Mantoue, commanditaire de l’œuvre dans les appartements où se déroulait la première représentation. C’est vif, tranché, ça augure d’une soirée riche en audace. En fait, il n’en sera rien et nous aurons droit à des égards trop déférents de la part du metteur en scène.
Si L’Orfeo n’est pas réellement le premier opéra, précédé par une Dafné (Peri) et deux Euridice (Peri et Caccini), il est la pierre fondatrice de l’art lyrique baroque. Pétrifié dans cette révérence, Gilbert Delfo prend le parti de nous renvoyer 400 ans en arrière et de nous convier à une représentation d’époque, mais qui nous semble aujourd’hui bien sage. Jordi Savall et ses musiciens sont costumés, tel que l’était Monteverdi dans son portait par Strozzi, le rideau de scène est remplacé par des miroirs pour recréer l’ambiance intime d’une représentation donnée dans un salon privé et la mise en scène suit le livret au premier degré.
Le choix du mythe d’Orphée n’est en rien anodin de la part de Monteverdi, il n’est en fait que le compositeur lui-même, détenteur du pouvoir d’ensorceler par sa musique et son chant son auditoire. D’ailleurs, dans l’opéra, Orphée ne meurt pas déchiqueté par les bacchantes mais est enlevé sur le char d’Apollon, dans une apothéose finale.
Mais si, en ce tout début du XVIIème siècle, la tradition pastorale perdure (mythe grec, retour en Arcadie, harmonie entre l’homme et la nature, fin heureuse…), ce livret où gambadent bergers et nymphes paraît vite un tantinet poussiéreux. Décor carton-pâte, petits bosquets désuets, toges et drapés, Orphée et sa lyre de pacotille, le spectateur se sent très très loin des occupations et des déboires de ces gens-là. Orphée est certainement le mythe qui donne lieu aux plus nombreuses interprétations qui soient. Pourquoi bouder cette richesse au profit d’une mise en scène champêtre et charmante mais qui ne nous dit plus rien aujourd’hui ? Où est la tragédie ? Où est la douleur d’un poète qui vient de faire plier les dieux mais que sa simple condition humaine fait chuter ?
Il faut dire que nous ne sommes pas gâtés côté interprètes, dont la piètre présence dramatique laisse l’histoire au rayon sucrerie. Ils sont raides, sans émotion, statufiés (mais les choix de Delfo feraient se figer n’importe quel chanteur !). Le rôle titre est porté par un baryton peu concerné par la compléxité de son rôle, accroché à sa lyre telle une bouée de sauvetage, ce sera fade et sans tension. Les autres voix ne faillissent pas mais ne sont pas non plus mémorables, à l’exception de la Messagère et de la Musica, (Sara Mingardo et Montserrat Figueras) intenses et porteuses enfin d’un réel engagement.
Demeure heureusement la musique, d’une modernité incroyable, d’une richesse instrumentale renversante. Il est inouï d’imaginer que la partition date de 1607 et qu’elle propose déjà autant de couleurs, d’invention, de ressources pour les chanteurs et les musiciens. Jordi Savall fait au pupitre ce qu’on attend de lui, manquant peut-être aussi d’un peu de fougue et de hardiesse pour porter cet Orphée au-delà d’une gentille bluette.

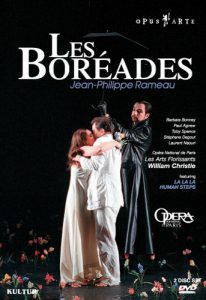
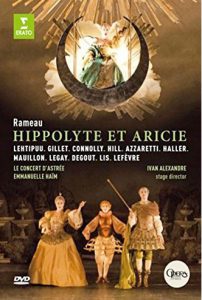
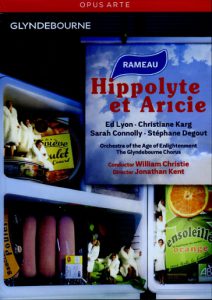
Bon alors, j’achète ce DVD ou pas ? D’un côté Jordi Savall je suis généralement fan. En ce moment, c’est son premier disque de Viole celtique que j’écoute à haute dose… D’un autre côté j’attends avec impatience l’Agrippina » de René Jacobs qui doit sortir à la fin du mois de septembre…
Que faire ?
Bonjour,
Oh là, ne compte pas sur moi pour émettre un avis sur tes achats Ce w-end, ce sera l’autre version d’Orfeo, celui dirigé par William Christie (j’en frétille d’avance). Ensuite, je me colle au deux postes sur deux versions de « Poppée ». Si tu le souhaites, envoie moi un mail avec ton adresse : je te prête le DVD et si tu es sous le charme, hop, tu fais chauffer ta CB. Tout simple.