
Iphigénie en Aulide (1774), Iphigénie en Tauride (1779)
Christoph Willibald Ritter von Glück
Enregistré au De Nederlandse Opera, Amsterdam, 2011 / DVD 2013
Dans la famille des amateurs d’art lyrique, on croise les férus du baroque, les amoureux du bel canto, les wagnériens, les groupies d’Amadeus… mais rarement des glückistes. Alceste, Orphée et Eurydice, les deux Iphigénie, et c’est à peu prêt tout ce que je suis capable de citer des opéras du monsieur. Glück reste bien souvent méconnu du grand public, coincé entre Haendel et Mozart, considéré comme austère, solennel, en un mot, barbant. On redécouvre un peu honteux l’œuvre du compositeur allemand depuis que des chefs plutôt orientés « baroque » ont soufflé la poussière des partitions : William Christie, Christophe Rousset, Marc Minkowski ont redonné vie à des pièces, qui sidèrent aujourd’hui par leur superbe et leur profondeur.
Et l’on comprend mieux ce que Glück modifie à la fin du XVIIIe, sur le plan musical, mais aussi dans la conception même de l’opéra : terminée l’alternance du récitatif et des arias, la musique doit porter le texte d’une manière fluide, harmonieuse et continue. Ce ne sont plus les interprètes et leur virtuosité technique qui doivent concentrer toute l’attention mais la seule musique, dépouillée de ses ornements superflus. Les grandes machineries, les longs ballets purement décoratifs, les décors imposants passent à la trappe, l’intrigue est resserrée autour de quelques personnages et d’une idée forte, pour davantage de simplicité et de naturel. Il faut évidemment des sujets à la hauteur de cet ambitieux chamboulement, et Gluck les trouve dans les grands mythes fondateurs, chargés de morale et d’idéaux. Mais morale ne veut pas dire moralisme, sermon, froideur et rigidité.
C’est là le tour de force de Glück, superbement illustré par ces deux Iphigénie (en Aulide et en Tauride), réunies dans une même soirée à Bruxelles, puis à Amsterdam et enfin dans le DVD d’Opus Arte. Les deux opéras, composés à cinq ans d’intervalle, n’étaient pas destinés à être joués à la suite. Mais il y a comme une évidence à suivre le destin de la princesse d’Argos, victime sacrifiée par Agamemnon en Aulide, puis retrouvée en exil en Tauride, quinze ans plus tard, sacrificatrice à son tour, pour de mêmes sombres raisons d’Etat. J’ai, en ce qui me concerne, une très nette préférence pour Iphigénie en Tauride, plus noir, plus dramatique, plus violent ; pas de roucoulades entre le ténor et la soprano, de tergiversations, de rêveries, de parenthèses de douceur, nous plongeons abruptement dans une tragédie enténébrée, dense, ramassée, sans que l’on puisse reprendre notre souffle. Glück excelle à révéler la dimension humaine des descendants maudits des Atrides, leur complexité, évitant le piège de la distanciation du spectateur avec les héros grecs. Il n’est pas seulement question de fatalité, d’honneur, de devoir, d’obéissance aux Dieux mais aussi de trahison, de vengeance, de colère, d’amitié et de justice.
La mise en scène d’Iphigénie en Tauride accentue encore cette contraction de l’intrigue par un rétrécissement de l’espace scénique, qui concentre le déroulé du drame : un simple plateau dépouillé figure l’autel des sacrifices, une fosse centrale accueille les cauchemars d’Oreste, torturé par les Euménides, deux escaliers encadrent la scène pour que règnent Artémis (Diane ici dans le livret) et Thoas, le Roi des Scythes, des symboles qui font sens (haches et gants noirs, entre les mains blanches d’Iphigénie), une alternance de lumières blafardes et acides, encerclent les lieux où les personnages se heurtent à l’inflexible autorité des Dieux sur leur destin, sans échappatoire. Même les musiciens sont relégués derrière la scène, les chœurs encore plus loin, derrière l’orchestre. Le regard du spectateur ne doit être perturbé par aucun filtre pour que naisse l’émotion. La mise en scène reste minimaliste, les costumes sobres, (même si peu flatteurs pour la silhouette d’Iphigénie), les déplacements limités, mais une touche de modernité, pas toujours de bon goût, transforme les Scythes en un bataillon de barbouzes en treillis sur-armés, prêts pour une guérilla, et leur Roi Thoas, en cruel tyran pervers, chaussé de Ray-ban, cigare aux lèvres. C’est un peu fatiguant cette mode de transposer tout guerrier en brute épaisse habillée de kaki, paré de son FM ou de son AK, et déjà tellement vu…
Mais il y a la musique et quelle musique ! Pas d’ouverture, de gazouillis, de gentils frottements d’archets, mais immédiatement un terrible orage qui s’abat sur Iphigénie et ses prêtresses, un déluge de cordes aussi violent qu’inattendu. Minkowski aime houspiller les tempi, intensifier, appuyer, accélérer, il trouve donc avec la partition matière à jubiler. Plus de musique de cour policée, mais une fougue, une hardiesse très moderne, une forte présence des percussions pour porter de fulgurantes dynamiques, comme cette danse barbare des Scythes au rythme saccadé (« il nous fallait du sang pour expier nos crimes ») et des contrastes d’atmosphères impressionnants, d’une très grande force dramatique ; ça ne traine pas, les deux heures passent prestement car jamais la tension ne se relâche.
Le rôle d’Iphigénie en Tauride, plus âgée qu’Iphigénie en Aulide, est souvent interprété par une mezzo, pour souligner le temps passé, les épreuves subies et la maturité venue. C’est pourtant Mireille Delunsch, soprano, qui s’y colle, rôle déjà tenu sous la baguette du même Minkowski en 2001. Ses qualités d’interprète, sa capacité à habiter un personnage, à le faire bouger, respirer selon le texte, ne sont plus à démontrer. Delunsch n’a pas la voix aussi pure et souple de Véronique Gens (qui incarne la première Iphigénie) et c’est sans doute tant mieux pour camper l’angoisse, la fébrilité, le malaise de celle qui cauchemarde du meurtre de son père par sa mère et qui s’apprête à devoir immoler son propre frère. Lorsque le rythme s’emballe, les fins de phrases ne sont pas toujours tenues, le souffle fluctue et le timbre flotte parfois, surtout dans les graves, mais le texte n’est ni poli, ni lustré et difficile à articuler :
« La terre tremble sous mes pas,
Le soleil indigné fuit ces lieux qu’il abhorre,
Le feu brille dans l’air, et la foudre en éclats
Tombe sur le palais, l’embrase et le dévore !…
A mes yeux aussitôt se présente mon père,
Sanglant, percé de coups, et d’un spectre inhumain
Fuyant la rage meurtrière;
Ce spectre affreux, c’était ma mère!
Elle m’arme d’un glaive et disparaît soudain,
Je veux fuir… on me crie: Arrête ! C’est Oreste:
Je vois un malheureux, et je lui tends la main,
Je veux le secourir; un ascendant funeste
Forçait mon bras à lui percer le sein ! »
On l’attendait sur les deux grands airs, signatures de cet opéra « Ô toi qui prolongeas mes jours » dans le I et « Ô malheureuse Iphigénie ! Ta famille est anéantie ! » à la fin du II. Si certains reprochent à Mireille Delunsch d’être « plus expressive que musicale », c’est qu’ils ont de sacrés problèmes d’audition. L’incantation à Diane et la grande scène d’affliction sont deux moments de grande musicalité, d’une délicatesse inouïe, comme une simple ligne instrumentale. La paire Oreste / Pylade (Jean-François Lapointe et Yann Beuron) est tout aussi satisfaisante ; le baryton et le ténor ont des timbres proches, qui se mêlent harmonieusement dans de touchants duos. Les solos sont puissants, convaincants, portent loin, avec une diction du texte magistrale.
Le DVD a tourné trois soirs de suite à la maison… pour la musique, les interprètes et un sublime livret aux qualités littéraires évidentes. « La voix, les instruments, tous les sons, les silences mêmes, doivent tendre à un seul but qui est l’expression ; et l’union doit être si étroite entre les paroles et le chant que le poème ne semble pas moins fait sur la musique que la musique sur le poème » – Gluck, 1777.

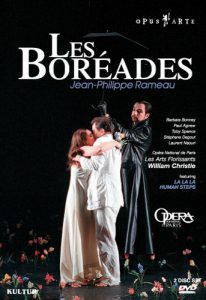
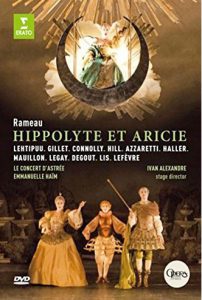
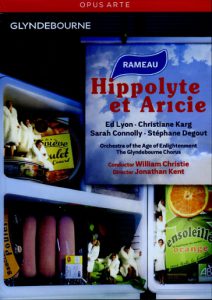
J’ai fait le rencontre de Glück que je connaissais mal à Grenoble il y a un petit mois. J’ai été enthousiasmée. Il faut dire que Minkowski et Bejun Mehta m’ont ravie, tu t’en doute… Orfeo ed Euridice dans une bien belle mise en scène sans outrances mais avec assez de faste pour retrouver ses yeux de petite fille. Le bonheur quoi !
A Grenoble ? Faut que je regarde sur le net s’il a des extraits quelque part, surtout que Orphée et Eurydice, c’est une superbe partition, je suis d’accord avec toi. Et puis, s’il y avait ton chouchou, c’était bonheur assuré On est tous pareil, on a nos têtes, nos voix, nos bêtes noires, comme les ados avec les chanteurs pop rock, mais nous c’est un autre registre. C’est chouette de rester fans et enthousiastes